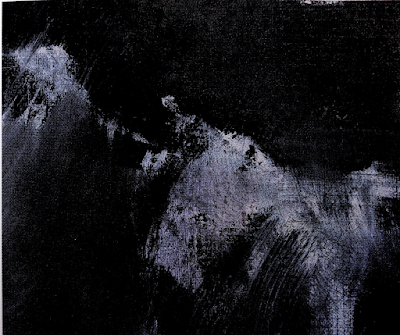vendredi 6 juin 2025
L'Ange écoute, de Philippe Roger
jeudi 7 novembre 2024
Juge et partie
mercredi 3 avril 2024
Denis Clavel par ses poèmes
- Fenêtre sur la mer, Gardet, 1963
- Le Chant du monde (Album d'art : Les Tapisseries de Jean Lurçat), Gardet, 1963
- Poésie suivi de Le Goût du feu et Journal d'un pharisien, Guy Chambelland, 1969
- La Genèse du poème, Guy Chambelland, 1972
- Opéra sur la vitre, Guy Chambelland, 1972
- Paysage clandestin, Gardet, 1976
- Distance apprivoisée (illustrations par Jacques Labrunie), Le Pont de l'Épée, 1978
- Les Regards contagieux (illustrations par Tal Coat), Le Pont de l'Épée, 1981
- La Ténèbre, suivi de Esquisse pour un sourire, Le Pont de l'Épée, 1983
- Lazare, Le Pont de l'Épée, 1984
- Le Chant de la créature, Éliane Vernay, 1988
- Le Poème, Le Pont sous l'eau, 1990
- Métier d'homme, Le Pont sous l'eau, 1990
- Porte d'âge (illustrations par Singier), Le Pont sous l'eau, 1992
- La Fin du temps, Le Pont sous l'eau, 1994
- La Théorie de Delphes, L'Âge d'homme, 2002
- Je ne vois aucune différence de principe entre un poème et une poignée de main, Édimontagne, 2007
- Le Livre du repos, Edimontagne, 2009
- Le Jardin de Talèfre, Édimontagne, 2011
- Infinition de l'heure, Esope, 2018
- Le temps ordinaire, Esope, 2020
- Monologue du silence, Esope, 2022
- Le Songe et les rêves, Esope, 2023
mardi 19 décembre 2023
Top 5 2023
- Anatomie d'une chute, de Justine Triet
- Oppenheimer, de Christopher Nolan
- La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar, de Wes Anderson
- Trenque Lauquen, de Laura Citarella
Et aussi : Mrs Maisel, I Think you should leave with Tim Robinson, Sambre
jeudi 20 juillet 2023
Oppenheimer - Morale quantique
samedi 17 juin 2023
John Gilbert, the great lover
Au milieu des années 1920, la MGM a besoin d'une star masculine pour répondre au phénomène Rudolph Valentino et jette son dévolu sur John Gilbert. Après d'éclatants succès, il est pourtant détruit par le système qui l'avait porté aux nues. Sous le double effet de l'arrivée du parlant et d'une relation plus qu'orageuse avec Louis B. Mayer, le patron de la MGM, John Gilbert voit sa célébrité se ternir du jour au lendemain. Sa tendance à l'alcoolisme, aggravée par ses échecs au cinéma, a raison de sa santé et il meurt d'une crise cardiaque en 1936. Avec des témoignages de journalistes, d'universitaires et de descendants de John Gilbert, le documentaire rend hommage au grand acteur injustement oublié et donne à voir, derrière la figure légendaire, le destin singulier d'un homme passionné.
mercredi 5 janvier 2022
Top 2021
Une année musicale :
1. West Side story
2. Annette
3. Encanto
Mais aussi :
Matt Damon dans Stillwater et The Last Duel.
L'ouverture d'In the heights.
Quelques films entêtants : Old, The Card Counter, Being the Ricardos, Les 2 Alfred.
Des heureuses découvertes : Boire et déboires (1987), Y aura-t-il de la neige à Noël (1996), Plus One (2019), Nos Plus belles années (1973)
mercredi 21 juillet 2021
Annette, de Leos Carax - the raging ape
La partition de Sparks reprend une habitude de la comédie musicale : celle des scènes purement descriptives où les personnages disent qui ils sont ("I'm the accompanist") ou se contentent de répéter leur état sentimental ("We love each other so much"). Ce qui a pu être perçu comme de la platitude ou un défaut de narration me semble être une tendance volontaire à s'attarder sur le cadre de l'action au lieu de la laisser se dérouler. En se décrivant eux-mêmes, jusqu'à la redondance - comme quand les personnages d'un musical clament "That's entertainment!" -, ces numéros prétendent révéler un ressort des situations dissimulé dans les apparences : ainsi le rire artificiel du public d'Henry McHenry (nom tautologique par excellence), bien loin de la réaction spontanée, sert à dépeindre un rapport de force entre l'humoriste et ceux qui l'écoutent. Systématisant cette idée, le film met d'ailleurs du rire partout, tout en se passant de la comédie : ainsi dépouillé de sa drôlerie, le rire n'est qu'un instrument de puissance. C'est quelque chose de vital et de monstrueux qui sert tantôt à tuer (les chatouilles) tantôt à donner vie (l'accouchement).
Les personnages d'Annette sont pris dans un rapport inextricable entre l'intériorité et l'extériorité. D'un côté, la musique expose leur sensibilité et en fait des coeurs à ciel ouvert, et de l'autre elle les embarque dans quelque chose qui semble les dépasser : les stéréotypes propres à cette forme musicale, mais aussi un rapport au tragique, au sentiment que tout est déjà écrit. Pour cette raison, le film offre une vision déstabilisante de la culpabilité, à la fois propre et impropre à décrire la marche implacable de son personnage principal vers la destruction. D'un côté il n'est que le jouet de cette "sympathy for the abyss" qu'il invoque à la fin du film, mais de l'autre, c'est bien sa toxicité propre qui contient tout le tragique de son histoire : c'est lui qui projette son amante en actrice vouée à la mort et son enfant en marionnette vouée à l'exploitation.
mercredi 30 décembre 2020
Top 2020
lundi 14 septembre 2020
A lire à propos de Tenet
- Un beau billet sur le blog L'oreille est hardie
- L'article de Camille Brunel sur Débordements
- L'article, plus réservé, de Sylvain Blandy pour Critikat
- Toujours sur Critikat, une discussion autour de Nolan, entre Thomas Grignon, Josué Morel, Sylvain Blandy et moi
- Sylvain Métafiot m'a posé des questions à propos de Nolan pour Le Comptoir
- J'ai aussi rédigé une notule pour La Vie, et un article sur Nolan pour La 7ème obsession n°30
mercredi 24 juin 2020
mardi 31 décembre 2019
Top 2019
Au cinéma
- Alice et le maire de Nicolas Pariser
- So long, my son de Wang Xiaoshuai
- Le Traître de Marco Bellocchio
- La Mule de Clint Eastwood
Chez moi
- Marvelous Mrs Maisel (saison 3) de Amy Sherman-Palladino
- Triple frontière de J. C. Chandor
- Succession (saison 2) de Jesse Armstrong
- I Think you should leave with Tim Robinson de Zach Kanin et Tim Robinson
lundi 26 août 2019
Ce qui résiste à l'Histoire
dimanche 28 juillet 2019
Spider-man : far from Hamlet
Spider-Man : far from home est le film idéal pour qui, comme moi, ne suit plus que d'un œil les sorties Marvel. Je me souviens m'être dit, devant Captain America : Civil war en 2016, que le studio avait bradé ses super-héros, qu'il était impossible désormais de prendre au sérieux cette farce en costume où chaque personnage n'est que le figurant d'une insipide histoire collective. J'ai d'ailleurs découvert les derniers développements de la saga dans l'introduction de ce nouvel opus de Spider-Man, avec tous ces gens qui se volatilisent et reviennent en un claquement de doigt. L'intérêt du film est d'intérioriser, via le personnage de Mysterio, l'idée selon laquelle les super-héros existent si peu qu'ils peuvent disparaître et réapparaitre à l'envi. Mysterio est un ancien employé de feu Tony Stark, cherchant à prendre sa place en simulant des combats épiques dont il est le héros : sous les apparences de l’affrontement super-héroïque se cache une armée de drones contrôlés par le félon. Entre les lignes, le film fait l’aveu de sa propre vacuité : l’illusion qui le fonde ne tient qu’à un fil.
mardi 4 juin 2019
Séances de mai et rattrapages cannois
 |
| Portrait de la jeune fille en feu (Copyright Pyramide Distribution) |
lundi 25 février 2019
Séances de janvier et de février
vendredi 28 décembre 2018
Top 2018
mardi 18 décembre 2018
Séances de décembre
Une affaire de famille, de Hirokazu Kore-Eda
Roma, d'Alfonso Cuaron